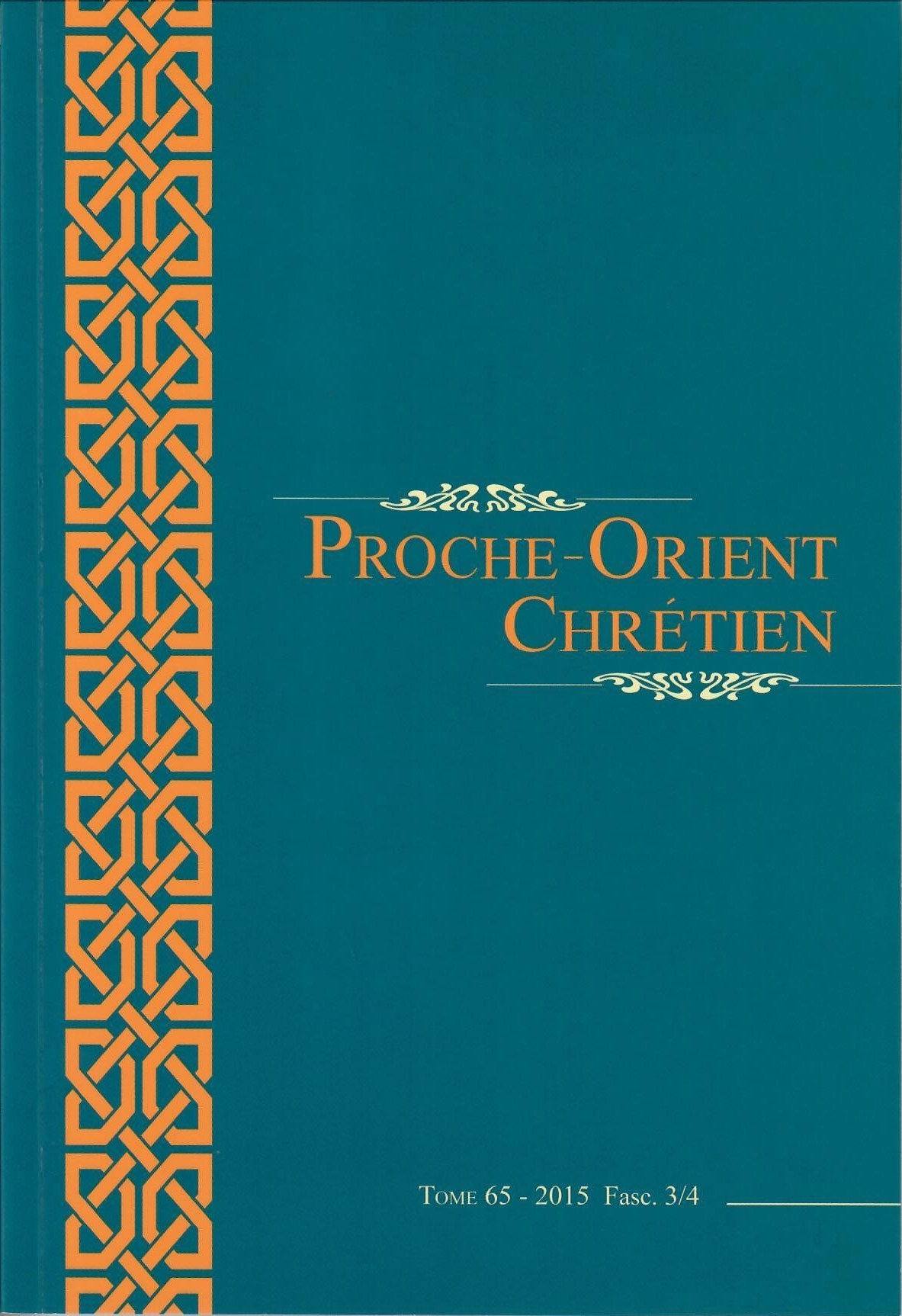Résumé
Pour pouvoir parler sérieusement de dialogue interreligieux, il faut d'abord préciser ce que l'on entend par religion. Il est nécessaire de distinguer « tradition religieuse », «institution religieuse » et « religiosité ». Il est de même important de réfléchir sur les personnes en dialogue, en l'occurrence des théologiens dans la majorité des cas. Que représentent-ils ? Leur propre opinion ? Le point de vue de l'institution à laquelle ils appartiennent ? S'agit-il d'un consensus entre théologiens ? Il faut reconnaître qu'il existe plusieurs et différents genres de dialogue. L'article relève trois exemples-types. D'abord, deux théologiens chrétiens qui cherchent à donner une place à l'islam au sein du cadre de leur propre théologie. Ensuite, deux théologiens amis, l'un chrétien et l'autre musulman qui réfléchissent sur la place à donner aux croyants d'une autre religion dans leur théologie. Enfin, une personne qui étudie le point de vue de plusieurs théologiens, deux chrétiens et deux musulmans, et relève les points de convergence et de divergence, parfois même à l'intérieur d'une même tradition religieuse.
Pour conclure : toute forme de dialogue interreligieux suppose une culture de dialogue qui est d'abord basée sur de bonnes relations humaines. Des formations pour favoriser une telle culture existent et doivent suivre différentes étapes. L'auteur nous y présente un exemple de ce genre de formation.