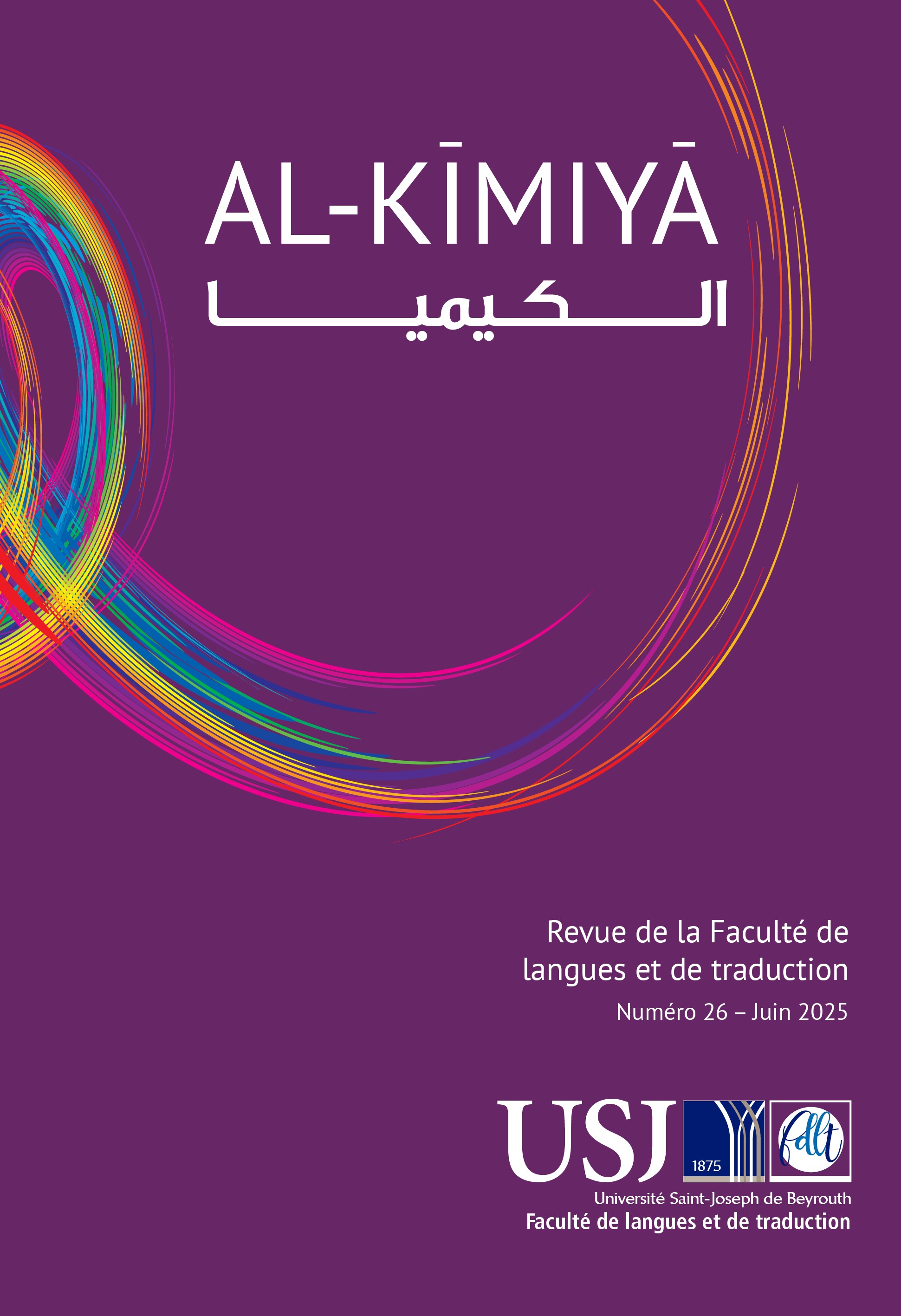Résumé
Cet article a pour objectif d’examiner les principaux mécanismes langagiers auxquels recourt souvent le discours éducatif universitaire « expert » afin de renforcer sa légitimité et son autorité. L’hypothèse centrale de cette étude soutient que le discours universitaire « expert » utilise une rhétorique langagière quasi technico-scientifique pour instaurer une illusion de rationalité et de performance, dans le but de désorienter la pensée critique et neutraliser l’esprit démocratique (Denault, 2016 ; Gobin, 2011). D’un point de vue théorique, la présente étude s’inscrit dans une optique critique pluridisciplinaire intégrant à la fois la socio-pragmatique, l’anthropologie linguistique, la philosophie politique et la sociologie critique des organisations. Sur le plan méthodologique, cette étude est fondée sur une approche « herméneutique » (Charaudeau, 2018) ayant pour objectif d’explorer les différents mécanismes discursifs utilisés par le discours éducatif « expert » et leur impact psychologique et pragmatique sur l’instance réceptrice. Elle combine l’analyse du contenu, des acteurs et des relations de pouvoir pour comprendre comment ce discours influence les normes et modèles éducatifs. Il ressort généralement de ce travail que le modèle expert puise dans une rhétorique technique et scientifique de manière à renforcer sa légitimité et asseoir son pouvoir symbolique vis-à-vis du public. En s’appuyant sur des arguments utilitaires et pragmatiques, la parole experte adopte une perspective technocratique et uniformisante, marquée par la primauté d’un paradigme techno-économique, au détriment de la dimension critique et controversée du discours scientifique et académique.