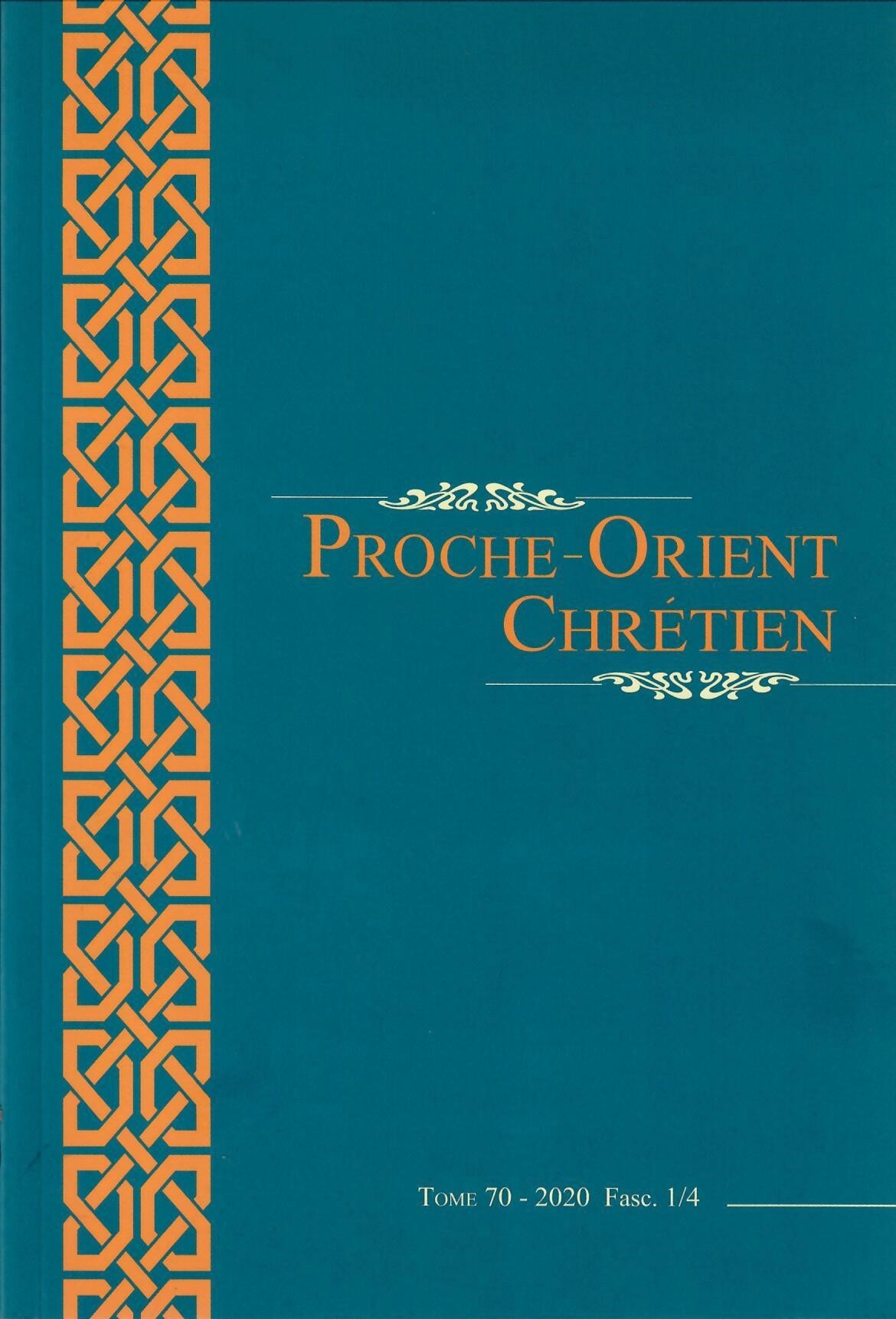Résumé
Il n’est pas dans les habitudes de Jacques de s’évertuer à établir explicitement des définitions et des spéculations sur des notions théologiques d’autant qu’il est mieux connu dans ses mimre en tant que poète et pasteur qu’en tant que théologien polémiste. Il propose le mystère de l’incarnation à la contemplation et à l’admiration des fidèles loin de toute scrutation indécente, soucieux de les mettre en garde contre les courants théologiques opposés à sa conception christologique de l’incarnation. Dans le creuset des débats théologiques des Ve-VIe siècles, la question qui se posait au sujet de l’incarnation se heurtait encore à l’enjeu de déterminer sous quelle forme elle s’est réalisée, dans le but de déceler le rapport et le mode d’union de la divinité et de l’humanité dans le Christ. Dans ses écrits, Jacques ne prétend pas élaborer un traité dogmatique remédiant à cette question, mais il part, dans ses développements, des contestations de ses adversaires, les réfutant sur la base de sa propre doctrine héritée principalement d’Éphrem de Nisibe et de Cyrille d’Alexandrie. [...]